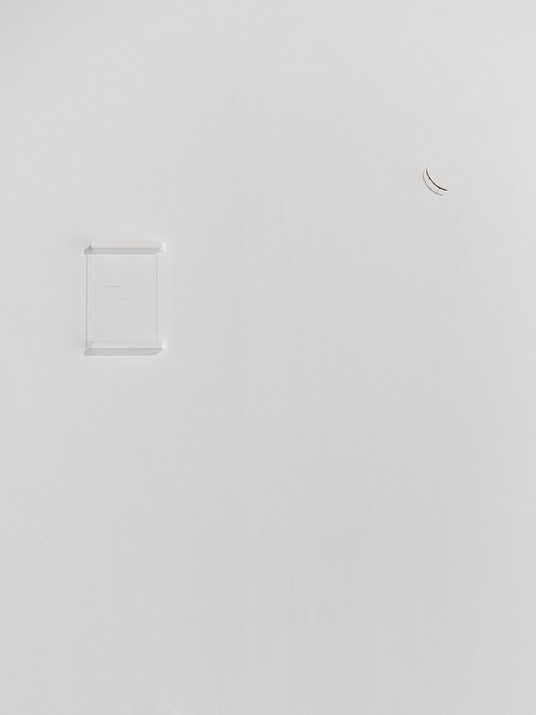Andar semi semi
[ Aller ensemble ]
13.09 - 20.12.2025
Maison des arts Agnès-Varda
Exposition personnelle de Camille Pradon
Proposée par Marie-Laure Lapeyrère
Commissariat de Pierre Duval
Vernissage le samedi 13 septembre
à partir de 17h
L'artiste remercie chaleureusement ses partenaires :
Le Département de la Seine Maritime, l’Institut français à Paris & Région Normandie, de l’Adagp, l’Institut français de Grèce et l’Auberge de France à Rhodes, la Ville de Rouen, ainsi que le programme curatorial Office of Hydrocommons, soutenu par la Fondation ATOPOS cvc (Athènes).
Eleni Riga (Office of Hydrocommons × ATOPOS cvc), Nour Amrani et Katherine Li Johnson (Tunis to This), M. Alexander Pelecanos et Mme Katerina Klonari, Mme Anouk Rigeade et l’équipe de l’Institut français de Grèce, Mme la Consule honoraire de France à Rhodes, la Station marine d’Endoume – Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie de Marseille, le Hellenic Centre of Marine Research à Héraklion, ainsi que toutes les personnes rencontrées entre les rives : Kerkennah, Sfax, Mahdia, Tunis, Kalymnos, Symi, Héraklion, Athènes, Rhodes, Rouen, Paris, Marseille.
Elle adresse également sa gratitude à la Ville de Grand Quevilly, à l'équipe de la Maison des arts Agnès-Varda, à Marie-Laure Lapeyrère pour son invitation et à Pierre Duval, commissaire de l’exposition.
« Andar semi semi »
ou comment traduire la nécessité de cheminer ensemble
L’exposition de Camille Pradon à la Maison des arts s’inscrit dans une recherche où se maillent les thèmes du langage et du déplacement et dont le titre vient souligner dans une même formule l’entrelacement de ces deux questions centrales pour l’artiste. En effet, « andar semi semi » signifie « avancer ensemble, cheminer main dans la main ». Il est écrit dans une langue qu’aujourd’hui nous ne connaissons plus ou si peu, la « lingua franca ». Cette langue franche est un sabir (de « saber », savoir en espagnol) utilisé comme langue véhiculaire dans le bassin méditerranéen du moyen âge à la fin du XIXe siècle.
Elle s’est constituée par l’agglomération de mots issus des différentes langues parlées par les populations qui entourent ce bassin méditerranéen en vue de se doter d’un outil de communication entre locuteurs aux langues maternelles étrangères. C’est une langue née de la volonté de traverser les frontières, transcender les séparations territoriales, c’est une langue de la mondialité (1), pour reprendre un concept d'Édouard Glissant ; une langue qui active cette idée de l’archipélisation des cultures méditerranéennes dont le souci principal est de parvenir à se rencontrer, à échanger, commercer, circuler et se déplacer.
Tant cette lingua franca que le titre lui-même, « andar semi semi » soit « cheminer ensemble », viennent traduire cet intérêt central pour le déplacement envisagé de manière aussi bien géographique qu’intime. Un cheminement qui ne peut évidemment s’envisager seul, qu’il s’agisse des raisons de celui-ci ou de ses modalités... Pourquoi nous déplaçons-nous ? Avec qui nous déplaçons ? Vers où nous déplaçons ? Comment nous déplaçons-nous ?
L’approche de Camille Pradon pour les langues constitue donc un écho très prégnant à cette question et aux fragilités qui l’accompagnent. Les langues agissent tels des outils d’ouverture nécessaire, elles sont des véhicules parfaits pour percer les frontières, recartographier des territoires. L’artiste précise d’ailleurs combien sa curiosité - qui l’a poussée à apprendre l’italien, à s'intéresser aux langues (parmi lesquelles l'arabe, le japonais et le grec), selon les différentes destinations de ses recherches - est une manière d’approcher dans toutes leurs complexités les différentes strates de savoir, pour mieux partir à la rencontre de l’autre.
Cette manière d’appréhender les mobilités, de façon littérale ou métaphorique, traduit indéniablement chez l’artiste le souci d’un décentrement du regard autant qu’une volonté de repenser la problématique des frontières et des échanges entre les êtres à l’aune d’une pensée qui pourrait être celle du « Tout-monde » de Glissant. « Un monde où les êtres humains, les animaux et paysages, les cultures et spiritualités sont en connexion mutuelle. Un monde où la géographie des idées, des désirs et des créativités, échappe au territoire et au système continental, et entre en relation et en archipels. Un monde où d’autres manières de vivre, de créer et de se rencontrer sont possibles » (2).
On peut ainsi considérer les œuvres et les recherches comme des outils pour apprendre à regarder et à ressentir autrement. De fait, elles traduisent incontestablement une ouverture au monde, aux cultures et aux différences qui nous constituent et dont nous oublions bien trop souvent la nécessaire richesse de leur enchevêtrement et de leur dialogue. Nous souhaitons à celle·eux qui viendront traverser cette exposition d’en faire intimement l’expérience.
Marie-Laure Lapeyrère
1. « Si la mondialisation est bien un état de fait de l'évolution de l'économie et de l'Histoire, et qu'elle procède d'un nivellement par le bas, la mondialité est au contraire cet état de mise en présence des cultures vécu dans le respect du Divers. La notion désigne donc un enrichissement intellectuel, spirituel et sensible plutôt qu'un appauvrissement dû à l'uniformisation que nous ne connaissons hélas que trop ». - http://www.edouardglissant.fr/mondialite.html
2. Aliocha Wald Lasowski, « Le Tout-monde d’Édouard Glissant : une chaosthétique romanesque » in « Refaire le monde Revue de Sciences Humaines », n°347, 2022
Faire témoin
Depuis les origines, les histoires s’écrivent par la mémoire de celles et ceux qui les ont vécues. Avec Andar semi semi [ Aller ensemble ], Camille Pradon s’aventure dans les profondeurs de récits oubliés, là où les voix assourdies trouvent un nouvel écho. En tissant des liens dans les interstices, elle arpente l’histoire, les histoires, et en propose d’autres chemins de lecture. Cette traversée indisciplinée bouleverse nos repères pour faire surgir des gestes suspendus, jusque-là figés dans l’immobilité. Une exploration de l’intangible rendue possible par la résurgence d’images et de mots enfouis en quête d’écoute, que l’artiste assemble avec patience.
En mettant à distance nos cadres d’interprétation par des mécanismes subtils, Pradon rend visible une intranquillité cachée et pourtant inscrite dans les moindres replis de l’espace. Dans cette agitation, la mer archive silencieusement trajectoires de vies, rites et gestes, autant d’héritages partagés, écrits dans le silence et parfois ensevelis dans les abysses. L’artiste y navigue en proposant une histoire des circulations, où chaque détail est porteur de vestiges mémoriels. Son approche du langage par captation – à la croisée de la gravure et de l’effacement – convoque un vocabulaire discret et fragile, bien que chargé de la puissance des éléments.
Pour mieux saisir l’essence sensible du temps, Camille Pradon déchiffre minutieusement ce qui s’imprime à la surface de l’existence. C’est d’ailleurs en explorant les effets de porosités entre surfaces et profondeurs que l’artiste travaille à découvrir la nature même du visible. Le témoignage, dans cette perspective, n’est pas une preuve ni un document figé, mais une matière mouvante, traversée d’absences et de surgissements. Il s’agit moins de reconstituer un récit que d’en révéler les failles, les silences, ces zones d’ombre qui résistent à l’interprétation et dessinent les contours d’une mémoire partagée. L’ellipse, motif récurrent dans le travail de l’artiste, agit ici un comme un outil narratif : elle crée suspensions et points de bascule d’où peut surgir une parole autre, fragmentaire et décentrée.
Ces traversées, qu’elles soient géographiques, affectives ou temporelles, déplacent notre rapport au témoignage. Elles le rendent poreux, vibrant, parfois vacillant. Ce n’est pas tant la restitution d’un récit qui importe ici, que la tentative d’en capter les résonances diffuses, les persistances souterraines.
D’un regard attentif, Camille Pradon adopte une vision et façonne des formes qui se glissent entre les lignes. Elle déchiffre dans ses marges, lit dans ses silences. Cette résonance entre les espaces et les temps génère une série de témoignages mouvants, construits dans l’intervalle et réassemblés par touches. Une trajectoire se dessine à travers les images et les artefacts présentés dans l’exposition, agissant chacun comme les réceptacles de voix oubliées : agora pour ces choses indicibles qui remontent à la surface et qui nous invitent à écouter, à relier et à transmettre.
Pierre Duval, commissaire de l'exposition
Visuel de l'exposition : La traversée, 2025 © Camille Pradon, Adagp
Ci-dessous : La langue dans la poche (2025), Melodos (2024-2025), Silence (2025)